Le mercantilisme
Dès le 14ème siècle, certains pays d’Europe basculent dans ce que l’on appelle aujourd’hui le mercantilisme. Fondé sur l’enrichissement des États, notamment en métaux précieux, une place prépondérante de ce dernier dans l’économie, un fort protectionnisme et une volonté d’industrialisation, ce courant de pensée hétérogène finira par disparaître au profit du libéralisme économique…enfin pas totalement.
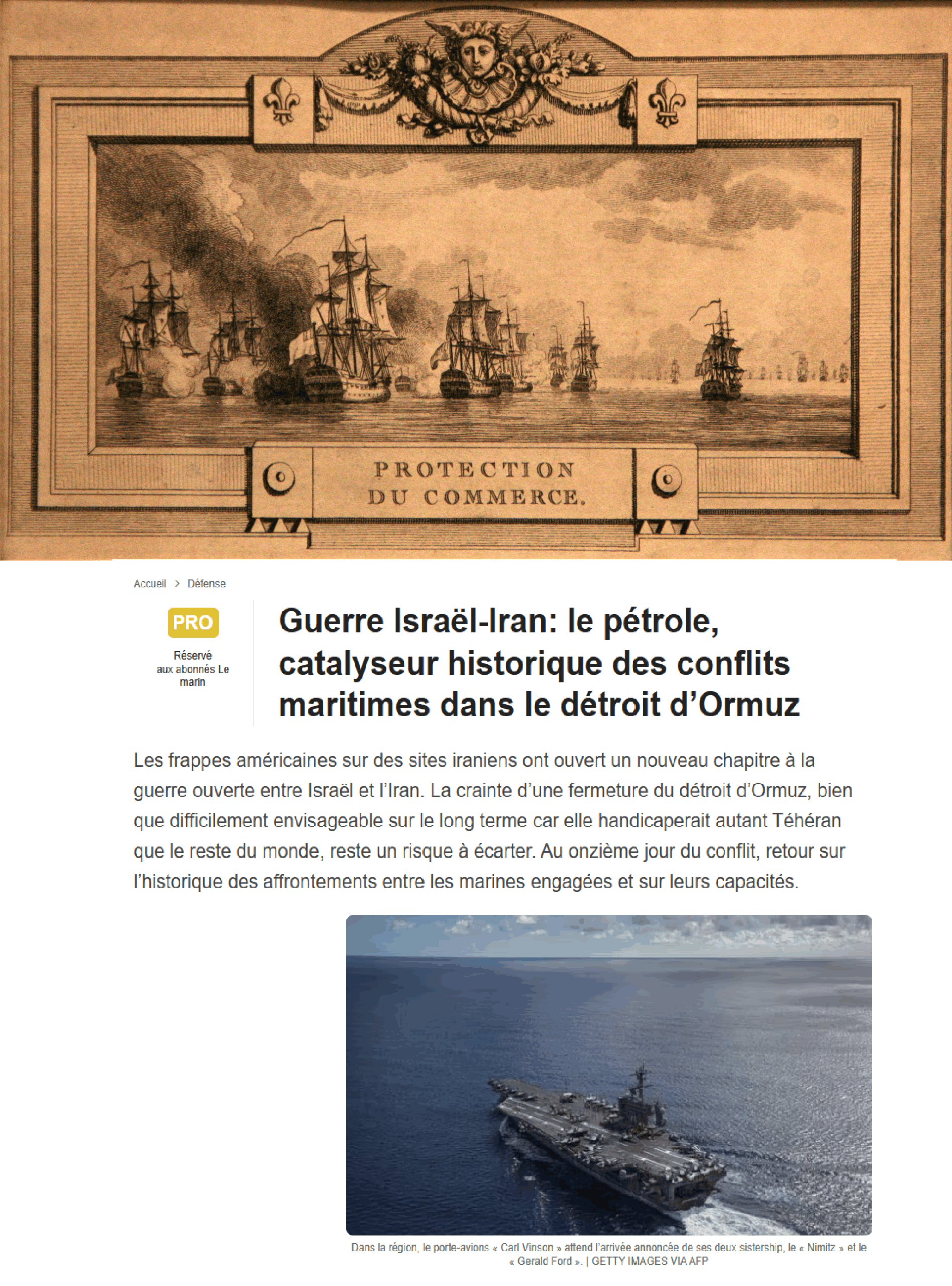
Introduction
Le mercantilisme ↱ n’est pas, à proprement parler, un courant de pensée économique, mais plutôt le regroupement, sous un seul terme, d’un ensemble d’économistes prônant un développement économique fondé sur l’enrichissement par le commerce. Le mot “mercantiliste ↱” a pour étymologie le mot italien mercante, qui signifie “machand”. Ce courant prend place en Europe du milieu du 14ème siècle au milieu du 18ème et prend fin avec la structuration du libéralisme économique, avec les écrits d’Adam Smith.

L’idée des mercantilistes est que les échanges entre les nations ne peuvent être qu’inégaux. Ainsi, chaque pays doit exporter ses biens afin de se procurer de l’or et fermer ses frontières aux importations. L’enrichissement des États passe par :
- l’accumulation d’or, notamment par sa collecte via l’impôt ou par la recherche de nouvelles mines via les conquêtes coloniales,
- la mise en avant du commerce intérieur, basé sur l’industrialisation,
- et enfin les exportations et leur excédent commercial.
On constate que ce type de pensée n’a pas totalement disparu : des politique de droite comme de gauche aujourd’hui, raisonnenent encore de cette manière. C’est un raisonnement caduque, car en silo : comme si l’industrialisation était découplée des politiques climatiques. Encore une fois, c’est soit de l’incompétence, un déficit d’éducation et de culture sur le sujet, soit un déni, soit de la manipulation.
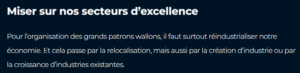
Mercantilisme espagnol
Le mercantilisme est avant tout un ensemble de courants de pensées économiques.
Le premier d’entre eux trouve naissance en Espagne et est connu sous le nom de bullioniste ↱, de l’anglais bullion qui signifie “lingot”. Comme son nom l’indique, le mercantilisme espagnol s’axe autour de l’accumulation des métaux précieux, or et argent en tête, issus de ses colonies d’Amérique latine. Dès le 16ème siècle, l’Espagne est à la tête d’un vaste empire colonial et contrôle des mines d’or et d’argent au Mexique, au Pérou ou encore en Bolivie.
L’idée est qu’il ne faut pas laisser l’or sortir du pays, non pas en épargnant, mais en pratiquant la thésaurisation, c’est-à-dire la conservation des richesses hors du circuit économique. Ainsi, l’Espagne met en place diverses interdictions, celles des sorties d’or du pays ou celles des importations et exportations, aboutissant à un très fort protectionnisme. Les conséquences économiques et sociétales, inflation et pénuries, seront catastrophiques pour le pays.

GLB semble avoir également du mal à comprendre les idées nouvelles. Timothée Parrique les explique bien pourtant.
En France
En France, à la même époque qu’en Espagne, se développe une autre branche du mercantilisme que l’on appelle colbertisme ↱. Les auteurs à l’origine de ce courant de pensée sont, pour l’essentiel, Jean Bodin ↱ (1530-1596), Antoine de Montchrestien ↱ (1575-1621) et Jean-Baptiste Colbert ↱ (1619-1683). Il sera largement misen oeuvre sous le règne de Louis XIV ↱ (1638-1715)
Si l’objectif du colbertisme reste l’accumulation de émtaux précieux, l’idée-force ici consiste en une forte intervention de l’État dans la vie économique, accompagnée d’un protectionnisme sélectif et d’un volontarisme industriel. Si Jean Bodin découvre les lois qui régissent ce que l’on appelle aujourd’hui la théorie quantitative de la monnaie ↱, l’histoire retiendra surtout les actions de Colbert. Ce dernier est, en effet, le premier à mettre en place une véritable politique économique en France. Cette dernière vise à renforcer la puissance de l’État en créant des manufactures d’État et en développant les infrastructures, les industries existantes et le commerce international.
“Plusieurs auteurs, dont notamment Martin d’Azpilcueta, Nicolas Copernic et Jean Bodin, croient discerner un lien entre la quantité de métaux en circulation et le niveau général des prix. Cette proto-théorie quantitative de Bodin est étendue par David Ricardo, et devient officielle et la seule enseignée. Karl Marx aussi abonde dans ce sens en déclarant que la monnaie masque la réalité des rapports de production et la vitesse de la circulation.” (Wikipedia ↱)

Le Mercantilisme fiduciaire ou commercialiste
On ne peut pas évoquer le mercantilisme sans parler de deux branches de ce courant qui ont eu leur importance sur le développement de la pensée économique, à savoir le mercantilisme fiduciaire et le mercantilisme commercial.
Le premier repose sur l’idée simple, et encore de mise aujourd’hui, que l’enrichissement d’un pays dépend de l’existence d’un système bancaire performant. En France, on doit au financier John Law ↱ (1671-1729) la création de la première banque centrale en 1716, la Banque générale, dont les trois fonctions étaient de recevoir des dépôts, d’émettre de la monnaie en échange de l’escompte de titres, mais aussi au moyen de prêts.
De son côté, de mercantilisme commercial prône un enrichissement basé essentiellement sur le commerce maritime. Il postule qu’une limitation de la consommation à l’intérieur du pays doit permettre d’augmenter le voume de biens disponibles pour l’exportation et affirme la nécessité de développer l’agriculture et la production de ressources naturelles.
La critique d’Adam Smith
Si le mercantilisme n’existe pas en tant que courant de pensée économique homogène, il est globalement critiqué, pour la première fois, par l’économiste Adam Smith ↱ (1723-1790) dans on ouvrage De la richesse des Nations. Smith y critique le “système mercantile” qui prône la pusisance militaire de l’État, ainsi que son intervention dans l’économie, amis aussi les protections douanières pour freiner les importations et les monopoles dans l’indutriealisation naissante.
Une des pierres d’achaoppement sera la monnaie. Pour les mercantilistes, elle est un bien plus précieux que les autres, alors que pour les classiques, la monnaie est un bien comme les autres, soumis lui aussi aux lois de l’offre et de la demande. D’un autre côté, au moment où l’Espagne s’engage dans une politique mercantiliste, une école de pensée se fonde à Salamanque, école qui est aujourd’hui considérée par certains comme le véritable précurseur du libéralisme économique. L’engouement pour ce dernier mettra fin au mercantilisme.
De nombreux économistes ou philosophes, comme John Locke ↱ (1632-1704) ou David Hume ↱ (1711-1776) font valoir que le commerce n’est pas un jeu à somme nulle, mais comme un jeu à somme positive. David Ricardo ↱ (1772-1823), qui développe la notion d’avantage comparatif, contribue à faire mieux comprendre les effets de la spécialisation internationale. (Wikipedia ↱)
Largement retranscrit du hors-série de Science & savoirs “Les bases de l’économie”
Des remarques, corrections, compléments à apporter à cette page? Venez en discuter sur ce post ↱ sur le groupe Facebook Namur politique
💰 Revenir au portail économie